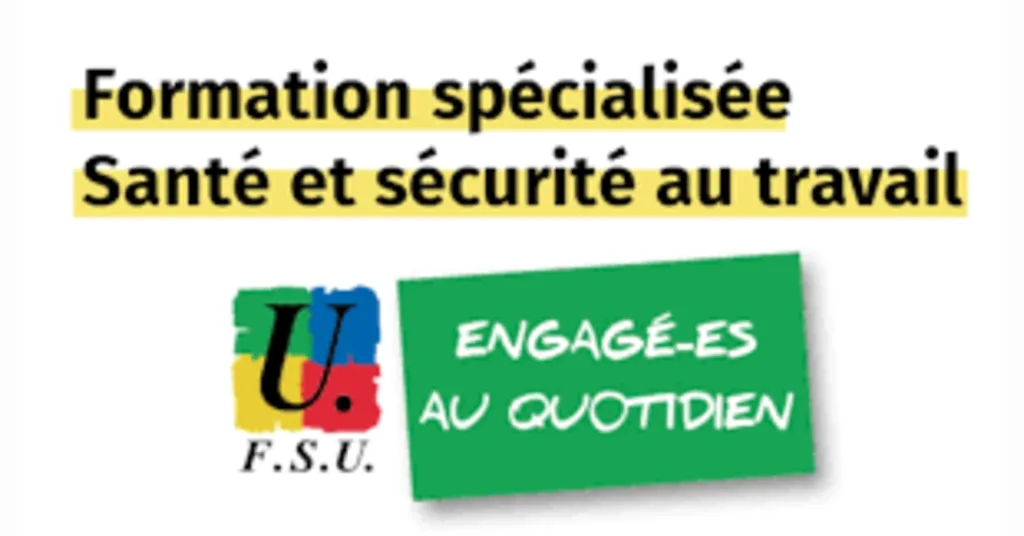Pour un appel à un dialogue social de « la besogne humaine »… Avant tout changement d’organisation !
Contextualisation
Ce choix de placer cette intervention en préambule des deux formations spécialisées permet d’en éclairer l’intention et le contenu au regard des difficultés budgétaires et de leur impact sur la politique des ressources humaines de la collectivité.
Dans ce contexte, la question du management de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des agents est centrale.
L’illustration des difficultés que nous rencontrons se caractérise dans la gestion du dossier du site Edouard Faure.
Le rapport de la visite sur site déplore l’insuffisante utilisation du Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST). Il y a une confusion, dans le contexte, entre le RSST et le registre des dangers graves et imminents côté au timbre de la formation spécialisée.
Le RSST a un objectif de prévention primaire, en amont de la réalisation du risque. Il permet aux agents d’être acteurs de leur santé, de leur sécurité et de leurs conditions de travail, de façon proactive en participant à l’amélioration de leurs conditions de travail.
Le registre des dangers graves et imminents porte bien son nom et est assorti d’une procédure (côté au timbre de la formation spécialisée) qui permet de situer le niveau de prévention secondaire voire tertiaire et l’urgence de la situation à traiter.
Cette procédure est la traduction du rôle et des pouvoirs que le législateur a souhaité confier aux représentants du personnel dans leurs prérogatives liées au droit d’alerte et au droit de retrait.
Nous renvoyons vers la présentation synthétique (fiche) de ces procédures par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de haute Savoie (CDG74), les modalités de mise en place et les finalités des registres.
Il est nécessaire de respecter le formalisme de ces procédures, in détachable de leur objectif de fond, à savoir l’obligation de garantie de la sécurité des agents due par l’employeur.
Dans le cas des ateliers du site Edouard Faure,
Compte tenu de la persistance des dysfonctionnements, la référence au RSST n’est pas adaptée. Ainsi que l’ont évoqué nos représentants et des agents du site, il s’agit bien de la mise en œuvre du droit de retrait dans l’éventualité où toutes les mesures nécessaires à la sécurité des agents sur le site n’auraient pas été respectées.
La FSU Territoriale invite donc la formation spécialisée à étudier ces mesures, dans le respect des bonnes pratiques et du droit des agents.
Le cadre de la gestion de la santé et sécurité au travail :
Au cœur du système de management de la santé et de la sécurité, les textes ont placé le dialogue social dont l’alimentation doit permettre la confrontation du travail prescrit par l’autorité territoriale et du travail réel des agents, dans une démarche nécessairement ascendante rendant les agents acteurs de leur sécurité, directement et par l’intermédiaire de leurs représentants.
Dans ce cadre, le souci de la qualité de l’information transmise aux représentants du personnel, la réactivité de la formation spécialisée et des services de la collectivité, sont essentielles.
Le règlement intérieur de la FS
Déduit des exigences légales en la matière, il ne peut se contenter d’un affichage des règles. Il faut les faire vivre et les transposer de façon adaptée à la situation de notre collectivité. Il y a fort à faire.
A notre connaissance, les précisions concernant le rôle des secrétaires de la FS qui devait être explicité dans une lettre de mission du président de l’instance, à l’époque du CHSCT, n’ont toujours pas été formalisées. Il ne s’agit pas seulement d’un rôle protocolaire mais du positionnement du secrétaire FS comme cheville ouvrière de l’animation concrète de l’instance avec l’ensemble des organisations syndicales et tous les acteurs de l’instance, dans une fonction de veille et de coordination.
L’objectif poursuivi dans l’élaboration du règlement intérieur, grâce au dialogue social, consiste à produire du « droit négocié » adapté aux besoins réels, dans un souci de performance. Au regard de la taille de la collectivité, du nombre d’agents, du nombre de sites et de problématiques sur le thème des conditions de travail, l’étayage du rôle du secrétaire de la FS n’est pas anecdotique, de même que le rôle dédié de l’administration dans l’information des élus de l’instance.
En son temps la FSU Territoriale a fait des propositions opérationnelles sur le sujet avec la volonté d’ouvrir un chantier sur le renforcement de la veille et de la réactivité de la collectivité sur ces questions. Ces propositions sont consultables sur notre site intranet.
A noter que ce sujet est très fortement intégré par les grandes administrations dans le registre du management et de la performance. Elles rattachent très souvent les missions d’inspection en santé, sécurité et conditions de travail, aux missions confiées aux inspections générales des services (IGS).
Le rôle pivot du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
Ce sujet peut paraître éloigné de l’urgence des situations examinées aujourd’hui, mais il n’en est rien suite à l’étude du rapport du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en date du 28 février 2024, consacré au DUERP dans la fonction publique territoriale (consultable sur le site du CSFPT).
La réalisation du DUERP est la démarche fondatrice de la gestion de la santé et sécurité au sein de la collectivité. Pour mémoire, l’obligation de réalisation d’un DUERP écrit remonte à 2001, l’obligation de réalisation d’un diagnostic des risques psycho-sociaux (RPS) intégré au document unique est établie en 2009 et reprise dans le protocole d’accord de la fonction publique en 2013 et dans tous les protocoles d’accord qui ont suivi.
Le document est dit « unique » en tant que support car il a vocation à récapituler et à rendre accessible à tous les agents, dans un seul document, les informations SST concernant leurs conditions individuelles et collectives de travail. Il est unique aussi car il est réalisé « sur mesures », en relation directe avec les activités réalisées par les agents de la collectivité, dans le cadre d’une analyse à 360 degrés de ces dernières, sous l’angle Technique, Opérationnel et Humain (méthode THO).
Le document est évolutif, nourri par le dialogue social, il enregistre annuellement les variations d’organisation du travail, l’introduction des nouvelles technologies et leurs impacts en termes de risques et de prévention.
Le document permet de définir annuellement les priorités en termes de formations en direction des agents, afin de les faire évoluer en compétences sur les risques de leurs métiers, de les protéger en les rendant acteurs dans la prévention des risques auxquels ils sont exposés.
Le rapport du CSFPT explore des pistes de simplification et d’allégement de la procédure du DUERP qui est apparue lourde et onéreuse, ce qui explique le nombre encore important des collectivités qui n’ont pas satisfait à cette obligation ou de façon partielle.
Il conclut cependant que cette démarche est incontournable dans la mesure où, d’expérience, elle est la clé de voute de la politique ressources humaines des collectivités territoriales !
Ainsi, la FSU Territoriale comprend que dans notre contexte de difficultés financière, avec le cortège de répercussions sur les effectifs du Conseil départemental, c’est une démarche ou du moins une méthode d’autant plus nécessaire pour notre collectivité, un levier permettant d’affronter les contraintes financières tout en respectant l’humain.
En effet, que signifie le nouveau paradigme d’un fonctionnement de la collectivité en « mode dégradé », sans remplacement des agents, avec des injonctions de faire rendues paradoxales par le sous-effectif chronique, aujourd’hui structurel ?
Quid du travail sur l’absentéisme en méconnaissant l’impact de ces nouvelles mesures sur la santé des agents ? Les statistiques des accidents de travail et maladies professionnelles de la collectivité « invisibilisent » les liens existants avec les conditions de travail et la réalisation des risques psycho-sociaux.
Une organisation responsable, comme le Conseil départemental, ne peut faire l’économie de cette approche pragmatique du travail, susceptible de la conduire vers la transformation et la résilience…
Ainsi, comme le rappellent nos camarades de la Protection Maternelle et Infantile, à l’occasion des 80 ans d’existence du dispositif, la politique de prévention relève de la bonne gestion à tous points de vue :
1 euro investi en prévention dans l’accompagnement d’une situation, valent mieux que les 7 euros qu’il faudra dépenser pour intervenir sur une situation largement dégradée.
En définitive, pour la FSU Territoriale, en priorité dans le respect et l’humain, rappelons-nous que les agents publics ne sont pas des dépenses mais des richesses. Disons « Stop » au gâchis !